Peter Knapp, grand artiste inclassable
Le photographe qui a fait changer le regard porté sur la mode
Peter Knapp est né en suisse en 1931 et commence la photo en 1945. Très vite c'est la peinture qui l'attire, il s'installe à Paris en 1952 et devient directeur artistique des Galeries Lafayette, puis du magazine Elle. Il fait changer le regard porté sur la mode, expérimente des techniques novatrices et développe son propre travail personnel de photographe. Reconnu également pour ses films et ses courts métrage, ce grand artiste s'intéresse à des projets toujours variés, au gré de ses rencontres et de ses envies.

Peter Knapp, en pleine aire numérique, vous n’avez pas de site internet pour votre travail. Pourquoi ?
Je suis très actif et je ne souhaite pas avoir de commandes. J’invente mes sujets et une fois que mon projet est bien, je trouve les gens qui vont y participer. De plus, ce que je fait est très souvent la conséquence d’une rencontre. Par exemple, il y a deux ans, j’ai rencontré un chirurgien par hasard dans un dîner, nous avons sympathisé, et il m’a parlé de son travail qui consiste à soigner des enfants qui ont la leucémie. J’ai trouvé terrible d’apprendre que la moitié de ces enfants meurent. Pour lui, la moitié de ces enfants survivent… De trouver quelqu’un qui peut affronter la mort d’enfants tous les jours et qui a suffisamment d’enthousiasme pour ceux qu’il sauve, m’a donné envie de travailler avec lui. Il m’a introduit dans son milieu, m’a permis de voir l’éducation qu’il y a autour de ces enfants, ce qu’ils écrivent, les dessins incroyables qu’ils font et qui reflètent leur maladie, et tous ça m’a amené à faire un livre.
Il y a quelques temps, j’ai rencontré un historien d’art, qui a passé quatre ans dans les sous-sols du musée de Van Gogh et qui a eu le droit de lire la totalité de sa correspondance avec la femme de son frère Théo : Joe. On connait bien la correspondance Vincent-Téo, mais de celle-ci on ne savait rien. De cette rencontre nait un film que j’ai co-réalisé : les derniers 70 jours de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Actuellement je suis en train de préparer une deuxième version qui passera à la Géode et qui vient de gagner un prix comme meilleur film pour son format adapté à cette salle spéciale. C’est pas que le film soit extraordinaire, d’ailleurs je trouve celui qui passe à la télévision est plutôt mieux, mais c’est la première fois qu’il y a quelque chose de culturel qui est adapté pour la Géode. Pour ma part, j’étais très enthousiaste à l’idée de tourner ce film avec une pellicule de 70mm, et je me suis vite rendu compte que c’était très difficile car on ne peut pas bouger la camera, et on ne peut pas faire de dialogues en direct.

Aujourd’hui est ce qu’on peut dire qu’avec tout ce que vous avez fait, vous pouvez vous diriger vers les projets qui vous intéressent le plus et choisir ce que vous voulez ?
En tout cas lorsque j’ai des idées je les mets en application et elles prennent forme. Mais c’est toujours assez long car il faut qu’elles atteignent l’obsession pour que je commence certains projets, de photo ou de film. J’attends toujours qu’une même idée, qu’un même précepte, m’intéresse plusieurs fois avant que je finisse par le faire devenir quelque chose. Parallèlement à cela, il y a toutes les expositions qui se font sur mon travail passé, et c’est aussi devenu une grande partie de mes activités. Il faut mettre à la disposition des organisateurs les éléments dont ils ont besoin, et ça prend du temps. Il y avait un très grand livre sur moi qui est sorti il y a deux ans aux éditions du Chêne, et donner tout le matériel nécessaire pour alimenter le contenu m’oblige à replonger dans mes archives.

Concernant le monde de la mode que vous avez côtoyé, vous gardez quelle regard de ce monde la ?
Je n’ai jamais vraiment été « un homme de mode ». Ma présence dans ce monde là était vraiment le fruit de la rencontre avec Hélène Lazareff, qui avait envie que la mode change de représentation. Dans les années cinquante, dans la haute couture nous étions là pour montrer le nombre de boutons des créations, ou que tout le monde puisse voir la fermeture éclair d’un ensemble, mais rien de plus. Il y avait une exigence d’informations et c’est ce qui justifiait aussi les commandes, et je les respectais.
Mais avec l’arrivée de cette femme et le journal Elle, nous avons découvert autre chose. Elle voulait des images plaisantes et des femmes qui n’avaient pas l’air de mannequins, qui dégageaient un peu plus de charme que d’habitude et avec lequel le lectorat féminin pouvait s’identifier. Le monde de la mode a toujours été plutôt tourné vers l’homosexualité chez les hommes. Mais là, elle voulait aussi que les maris de ses lectrices feuillettent le journal. A l’époque c’est elle qui avait inventé le slogan « Le journal pour les femmes, que les hommes regardent. »
Moi je suis venu à la mode à travers cette demande. Malgré tout je me suis très vite aperçu que la mode ce n’était pas ça qui me séduisait. Ce qui me séduisait dans ce milieu était la femme, et créer des situations autour d’elle. C’était donc quelque chose d’heureux pour moi car Hélène Lazareff attendait plutôt les mouvements de la femme, et c’est une merveilleuse base pour faire des photos.

C’est donc à cette époque que vous avez utilisé cette technique de filmer les modèles et de faire un arrêt sur image pour n’en garder qu’une photo. C’est quelque chose que vous avez inventé ?
A l’époque on travaillait beaucoup au Hasselblad, et même pour moi au départ au Rolleiflex. Comme on y voit à l’envers dans le viseur, on n’arrive pas à suivre quelqu’un dans une perspective de mouvements qui m’intéressait. Les caméras à moteur n’existait pas encore, alors j’avais acheté une Bolex Paillard 16mm que j’utilisais souvent dans le sens de la hauteur. Je leur faisais traverser la rue, monter un trottoir ou descendre de voiture, ça donnait un peu l’équivalent d’une planche contact d’aujourd’hui. Mon collègue Lindberg par exemple, shoote avec un appareil qui lui donne du 11 images par secondes et lorsqu’il fait dix films, il a 360 photos. Donc le choix de l’image pour lui revient quasiment au même travail que ce que je faisais dans le temps avec la caméra 16mm.

Vous qui avez un œil sur la mode, la photo, et qui avez travaillé au Galeries Lafayette en tant que directeur artistique, que pensez-vous du travail de Jean-Paul Goude dans ses publicités pour les Galeries ?
C’est sensationnel ! Je trouve que Jean-Paul Goude est un des meilleur « faiseur d’images », il ne se contente pas de la demande, il invente ses personnages, il les transforme. Il prend n’importe qui et ce n’importe qui devient quelqu’un à travers lui. Grace Jones par exemple, c’est lui qui l’a faite. Elle voulait chanter mais elle était mannequin au départ. Elle n’était pas très douée comme mannequin non plus, mais elle avait une gueule ! Il l’a rendu célèbre. Je trouve qu’aux Galeries Lafayette c’est presque le contraire : il a pris une des personnes qui est la plus connue dans la mode, Laetitia Casta, mais il a transformé Casta totalement, en personnage des Galeries Lafayette, presque méconnaissable. C’est ça qui est formidable chez lui, c’est qu’il créé des personnages, connus ou pas connus, et fait grandir les personnes qu’il photographie.
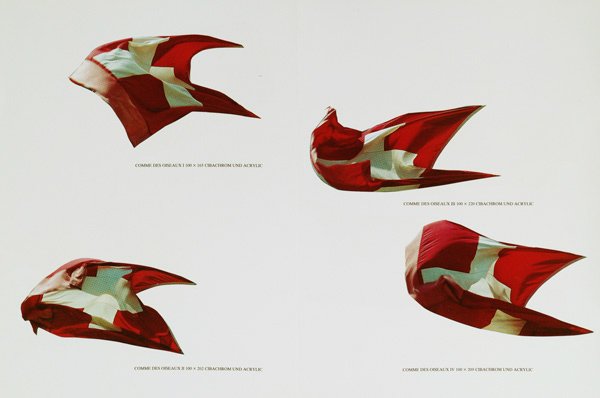
On dit de vous que vous êtes un artiste inclassable, vous vous reconnaissez dans cette description ?
Tout à fait. La liberté de ne pas dépendre d’un style se retrouve dans tous les projets sur lesquels je travaille, et cette liberté est extraordinaire. Goude malgré tout est obligé de faire du Goude, parce qu’il adore la commande. Moi j’invente ce que j’ai envie de faire, et il se trouve que je suis suffisamment bon pour en vivre quand même. Je n’ai pas besoin d’un style pour vivre, donc je suis inclassable. Si je voulais être un peu méchant je dirais d’un style que c’est un ornement, une manière, et si on devient maniériste à cause de la manière, l’œuvre diminue. Ou alors, c’est une façon de recommencer toujours la même chose, il y a des gens comme Giacometti qui sont dans ce cas là, mais sa recherche se passe à un tel niveau que ça n’a pas l’air d’une répétition. Sa recherche est devenu une œuvre.

Vous avez connu Warhol, vous en gardez quoi de cette époque ?
Je pense que c’est peut-être l’homme le plus important du dernier siècle. Il a dit des choses simples, les gens en ont ri mais c’est tellement vrai. Il a dit « nous sommes tellement nombreux maintenant, il n’y a donc aucune raison de n’avoir qu’une œuvre ». Il a donc inventé le multiple : il faisait une lithographie à 500 exemplaires, aujourd’hui elles valent chacune 250 000$ . Mais à partir du moment ou quelque chose est de qualité, et même s’il existe en plusieurs exemplaires, ce n’est pas gênant. Le multiple est une invention qui lui appartient, je trouve, et c’est une chose réellement importante. Il faut voir aussi qu’il a eu le courage de revenir à une image populaire, a un moment ou les dieux sont Picasso, Matisse ou Braque. Être artiste et peindre une boite de conserve de soupe, il fallait le faire !

Cette photo de Françoise Fabian fumant une cigarette, elle vous représente un peu ? Elle est importante pour vous ?
Ce n’est pas la photo la plus importante pour moi. Mais ceci dit, lorsque quelqu’un fait des expositions régulièrement, il a une préférence. Et à travers les publications et le temps, la photo devient une icône pour cette exposition. En Amérique ils ont utilisé une main de ma voisine qui maintenant est restée comme une sorte de référence, et c’est souvent l’affiche et les invitations qui font qu’une photo devient un peu une icône.

Quand des journalistes vous posent des questions, vous emmènent-ils parfois sur des sujets qui ne vous intéressent pas ?
L’image m’intéresse tellement et m’a toujours captivée, je ne verrai donc pas un seul sujet sur lequel je ne serais pas susceptible d’être interrogé. Mais concernant mon travail, c’est vrai que ce que j’ai fait auparavant perd un peu d’intérêt sur ce qui va devenir. De plus, je n’ai pas vraiment l’impression de travailler sur une œuvre, comme je l’ai déjà dit, j’ai l’impression d’aller de projets en projets, et d’essais en essais. Donc je ne suis pas quelqu’un qui aurait plein de respect pour une chose en particulier que j’ai fait. Je n’aurais pas non plus de regrets à ce qu’une des choses que j’ai créée ne devienne pas une icône.

Pas de fil rouge dans votre travail…
Non. Mais parfois quand j’ai une demande, elle se croise avec quelque chose que j’avais déjà envie de faire. Dans ce cas là, ça devient pour moi une thématique importante. Dans la photographie, ce que je trouve généralement intéressant, c’est l’éphémère. La photo justement se justifie dans l’instant, elle rend monument une chose qui passe. Un simple nuage, de toute l’existence du monde, il n’y aura que le moment de la photo où il sera comme ça, il ne le sera plus jamais ni avant, ni après. Un bateau qui passe en mer et qui laisse une trace, la laisse pour très peu de temps. Pour moi une photo d’une trace qui s’efface me fascine.

Ce livre justement, sur les enfants leucémiques, vous avez eu l’impression de saisir l’instant de ces êtres entre la vie et la mort ?
J’ai pleuré en le faisant, c’était une énorme émotion évidement. Pour moi le souvenir de ce livre c’est l’émotion en lisant les textes de ces enfants et de les publier avec mes photographies.
Interview par RD, 16 avril 2009
